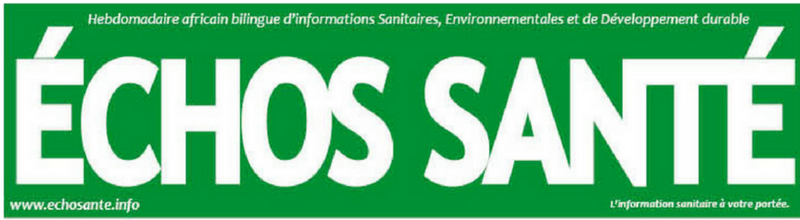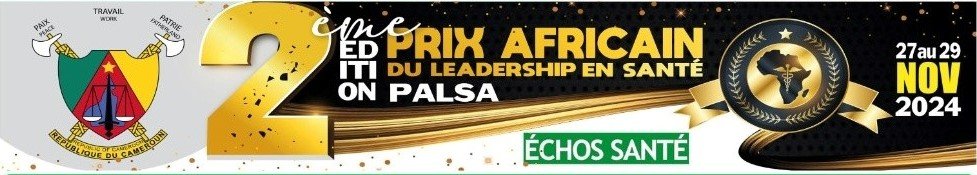Dans un pays où le taux de mortalité maternelle s’élève à 416 décès pour 100 000 naissances vivantes, les maïeuticiens – sages-femmes masculins – émergent comme des acteurs clés dans l’amélioration de la santé reproductive..
« Ma vocation est née le jour où j’ai accompagné ma sœur à l’hôpital pour son accouchement. En voyant sa souffrance, j’ai voulu comprendre le mystère de la naissance », raconte Brice Sillatchom, maïeuticien depuis six ans. Son parcours illustre les exigences de cette profession méconnue. « La formation dure trois ans, sous la double tutelle du ministère de la Santé publique et de l’Enseignement supérieur. Être un bon maïeuticien exige détermination, patience et empathie », précise-t-il. Dans la région de l’Ouest du Cameroun, Bienvenue Kamala incarne l’engagement territorial. « Ma mission dépasse l’assistance médicale.
Je prends en charge les femmes autochtones et les déplacées internes fuyant la crise sécuritaire du Nord-Ouest », témoigne-t-il depuis l’hôpital de district de Foumbot. « Dans ma promotion, nous n’étions que trois hommes sur 130 étudiants. Les moqueries étaient inévitables, mais aujourd’hui, mes camarades apprécient mes conseils », confie Charles, sage-homme. Son expérience révèle les défis de l’intégration. Les couples sont d’abord surpris de voir un homme, mais cette barrière tombe rapidement. Les patientes apprécient finalement cette approche masculine différente. »
Une reconnaissance institutionnelle croissante
L’UNFPA soutient activement ces professionnels. « Les sages-femmes réduisent de 45 % le risque de mortalité maternelle. C’est la stratégie la plus porteuse », affirme Noemi Dalmonte, représentante adjointe de l’agence onusienne. Le gouvernement camerounais s’est engagé à augmenter de 10 % d’ici 2026 les accouchements assistés par du personnel qualifié. Un objectif ambitieux qui passe par le déploiement de maïeuticiens dans les zones prioritaires. Comme le souligne Brice Sillatchom, « cette profession offre des débouchés variés : cabinet privé, hôpitaux, ONG. Un maïeuticien peut gagner décemment sa vie, mais l’essentiel est d’avoir du cœur ». Alors que le Cameroun commémore depuis 2009 la Journée nationale de la sage-femme et du maïeuticien, ces professionnels démontrent quotidiennement leur valeur dans la construction d’un système de santé plus résilient et inclusif.
La formation des sages-femmes, suspendue en 1987 pour des raisons budgétaires, connaît un nouvel essor grâce à l’appui technique et financier de l’UNFPA. « Cette relance s’inscrit dans le cadre du programme de renforcement des ressources humaines en santé de la reproduction de la campagne d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique ». Le déficit était alarmant : en 2011, le Cameroun ne comptait que 122 sages-femmes diplômées, dont seulement 4 dans le secteur public, pour un besoin estimé à 5 400 selon les normes internationales. Cette pénurie a contribué à l’augmentation du ratio de mortalité maternelle, passé de 430 à 782 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 1998 et 2011.
Une formation complète et adaptée
Pendant trois ans, les étudiants apprennent à pratiquer « l’accouchement normal, la détection des dystocies, les soins aux nouveau-nés, la consultation prénatale recentrée et la gestion des urgences obstétricales », témoigne l’UNFPA. Au-delà des compétences techniques, l’empathie et l’écoute active font partie intégrante de leur formation. Les responsables des établissements hospitaliers se montrent également enthousiastes, voyant dans ces nouvelles promotions. Malgré cet engouement, la profession reste confrontée à des difficultés persistantes : reconnaissance limitée, revenus modestes et perspectives de carrière restreintes. L’agence onusienne s’investit donc également dans l’insertion professionnelle des diplômés, en collaboration avec les ministères de la Santé et de la Fonction publique. Le déploiement de jeunes diplômés vise non seulement à offrir des prestations de qualité en santé de la reproduction, mais aussi à renforcer leurs aptitudes pratiques sur le terrain. Alors que le Cameroun poursuit sa lutte contre la mortalité maternelle, la renaissance de la formation des sages-femmes apparaît comme un investissement essentiel pour l’avenir du système de santé national.
Elvis Serge NSAA
INTERVIEW
« La passion transcende les genres. »

Dr Odou’ou Yannick Hilaire.
Avec un parcours académique impressionnant et sept ans de pratique, le Dr Odou’ou Yannick Hilaire incarne la nouvelle génération de maïeuticiens camerounais. Dans cet entretien, il revient sur sa vocation née d’un héritage familial, son expérience unique en tant qu’homme dans une profession majoritairement féminine, et son combat pour la reconnaissance d’un métier essentiel à la santé maternelle.
Comment êtes-vous devenu maïeuticien ?
La maïeutique est bien plus qu’un métier pour moi, c’est une passion quotidienne. Aider des femmes à donner la vie procure une satisfaction inégalable. Depuis mon enfance, cette vocation d’apporter du secours aux autres m’animait. Devenir sage-femme s’est imposé comme l’aboutissement naturel de ce rêve d’enfant.
D’où vous vient cette passion ?
Curieusement, elle puise sa source dans mon patronyme. Je porte le nom d’un homonyme, qui était réputé pour sauver des vies dans la tradition. Comme le dit l’adage, « il y a la part du nom » : cet héritage onomastique a confirmé ma destinée : vouloir sauver des vies, particulièrement celle du couple mère-enfant.
Quel a été le déclic définitif ?
La révélation est survenue à travers une expérience personnelle douloureuse. Mon défunt grand-frère rencontrait d’importants problèmes de conception. Encore étudiant, j’ai développé des protocoles qui lui ont permis de devenir père de trois enfants. Cette réussite familiale a validé mes compétences et renforcé mon engagement à apporter ce bonheur à d’autres couples.
Comment vivez-vous le regard de la société sur un homme dans cette profession ?
Les préjugés persistent effectivement. Beaucoup considèrent encore l’obstétrique comme un domaine exclusivement féminin. Pourtant, la passion transcende les genres. Pour moi, c’est une seconde vie. Des études montrent d’ailleurs que les hommes, sans porter la grossesse, peuvent parfois mieux la comprendre que certaines consœurs.
Quelle est votre relation avec vos patientes ?
Ironiquement, je suis l’un des praticiens les plus sollicités. Le secret ? L’écoute active. Un bon professionnel sait d’abord écouter, analyser, puis proposer des solutions adaptées. Mon enseignant disait : « On réussit l’accueil lorsqu’on arrive à faire sourire un patient. » Cette philosophie guide ma pratique.
Pouvez-vous partager une anecdote significative ?
Durant ma formation, j’étais le seul homme parmi toutes ces femmes. Cette singularité aurait pu être difficile, mais la bienveillance de mes consœurs a renforcé mon amour pour le métier. Aujourd’hui encore, malgré la distance, nous restons unis par ce lien ombilical forgé pendant nos études.
Rencontrez-vous des réticences de la part des patientes ?
Contrairement aux attentes, je n’ai jamais essuyé de refus, même parmi les femmes musulmanes souvent perçues comme plus réservées. La clé réside dans l’approche et la qualité de l’information fournie.
Depuis combien de temps exercez-vous et quelle est votre expérience ?
Cela fait sept ans que je pratique. Je réalise en moyenne 10 à 15 accouchements mensuels. J’ai été formé à Douala, dans un centre de référence qui enregistre plus de 100 accouchements par mois. Cette formation d’excellence me permet de transmettre à mon tour un savoir-faire éprouvé.
Quelles sont les principales difficultés du métier ?
Notre profession souffre d’une reconnaissance insuffisante. Alors que nous sommes essentiels dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle, nous restons relégués au second plan. Cette marginalisation a des conséquences directes sur la morbidité néonatale et maternelle.
Quel souvenir gardez-vous de votre premier accouchement ?
Ce fut un moment magique et intense. Voir la tête du bébé franchir l’appareil génital, recevoir ce nouvel être dans ses mains… J’ai connu le « syndrome du débutant » : les mains tremblantes, ce doute : « Suis-je à la hauteur de cet espoir ? » Cette scène m’a habité pendant des jours, comme si j’avais remporté un trophée. Cette fierté intérieure continue d’alimenter ma passion.
Propos recueillis par Elvis Serge NSAA
Leave a reply
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.