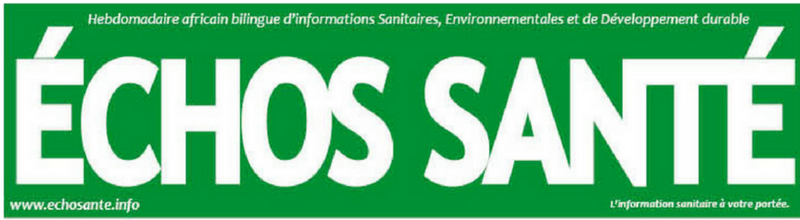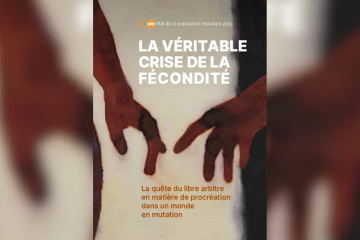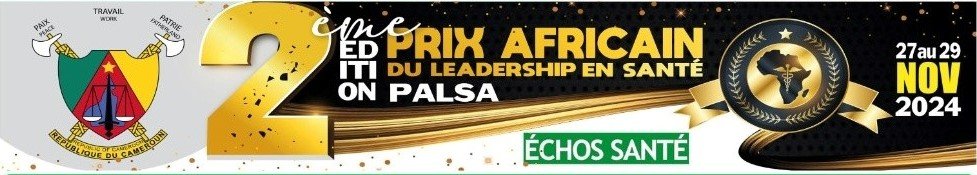«Le Permis d’Exploitation du Bois d’Œuvre (PEBO), qui leur serait normalement destiné, est gelé depuis 2012. »

Guillaume Lescuyer lors de l’ Atelier de cloture du projet PROFEAAC: “pour une exploitation artisanale légale et durable du bois en Afrique centrale”.
Guillaume Lescuyer, chercheur au CIFOR et au CIRAD, coordonnateur du projet PROFEAAC.
Quelles sont les raisons qui ont motivé le lancement du projet de promotion de exploitation artisanale du bois en Afrique centrale (PROFEAAC)?
Négligée, voire criminalisée, la filière artisanale de l’exploitation du bois au Cameroun est pourtant le principal fournisseur de bois d’œuvre pour la consommation nationale. Que ce soit pour construire une maison, acheter un lit ou même un cercueil, les Camerounais dépendent de cette activité. Malheureusement, malgré son rôle crucial dans l’approvisionnement en matériaux de base et son impact direct sur le développement du pays, cette filière reste informelle, ce qui entrave son potentiel de croissance. Il est temps de reconnaître sa contribution significative afin de mieux l’encadrer et la soutenir pour un développement durable.
Quelle sont les dates de début et de fin du projet? Qui sont les partenaires financiers et à quelle hauteur ont-ils contribué?
Ce projet a débuté en début 2020 et doit s’achever le 30 juin 2025. Il totalise ainsi cinq années et demie d’opérations. Son extension est due notamment à la pandémie de COVID-19. Il est essentiellement financé par le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) à hauteur de 2 millions d’euros et bénéficie également de cofinancements de partenaires tels que la GIZ, l’IRD, le CIFOR et Tropenbos – RDC.
Au Cameroun, vous avez principalement travaillé dans les localités de Mindourou et Dzeng, pourquoi ces deux choix?
Le projet ne s’est pas limité à ces deux communes, mais a adopté une approche intégrée en incluant des travaux à Yaoundé et sur l’ensemble de la filière. Le choix de Mindourou et Dzeng, l’une proche de Yaoundé, fortement dégradée et peuplée, et l’autre plus éloignée avec une forêt de meilleure qualité et moins de population, visait à obtenir des cas contrastés. Cette diversité a permis une analyse plus complète du fonctionnement de la filière bois à l’échelle nationale, offrant ainsi des perspectives enrichissantes.
Au cours de vos travaux, quels constats majeurs avez-vous fait sur le terrain?
Les récentes observations confirment une hypothèse clé: la filière artisanale du bois est non seulement efficace, active et dynamique, mais ses acteurs sont également prêts à professionnaliser leurs pratiques et à s’engager vers la légalité. Cependant, cette transition est conditionnée par l’ouverture des marchés urbains à leurs produits, ce qui offrirait ainsi des débouchés concrets à ces nouvelles approches. Ce constat souligne l’importance d’un soutien institutionnel pour permettre à cette filière de s’épanouir pleinement dans le respect des norms réglementaires.
Alors, si ces acteurs sont prêts, qu’est-ce qui fait problème?
Un obstacle majeur pour les exploitants artisanaux de bois au Cameroun réside dans l’absence de permis d’exploitation. Le Permis d’Exploitation du Bois d’Œuvre (PEBO), qui leur serait normalement destiné, est gelé depuis 2012 et n’a toujours pas été réactivé. Cette situation contraint ces petits exploitants à opérer dans l’informalité, car le ministère des Forêts ne leur délivre pas le document nécessaire pour légaliser leurs activités.
Mais, et cela peut sembler un paradoxe, cette informalité n’entrave pas toujours leur efficacité. Ces exploitants parviennent souvent à être très productifs, générant des revenus et fournissant des volumes de bois d’œuvre de plus en plus importants sur le marché domestique. Leur capacité à répondre à la demande du marché, malgré le manque de cadre légal, témoigne de leur dynamisme et de leur rôle crucial dans l’approvisionnement national. Par exemple les prix des sciages sur les marchés de Yaoundé et de Douala ont très peu augmenté depuis quinze ans, si on déduit l’inflation.
Cependant, cette situation a des répercussions négatives. L’absence de contrôle rend difficile la prévention des injustices au sein de la filière et, surtout, empêche d’avoir une idée précise de l’impact de cette activité sur la forêt. L’informalité empêche un suivi rigoureux et une gestion raisonnée des ressources forestières, soulevant des préoccupations quant à l’avenir de ces écosystèmes.
Quelles sont les essences les plus concernées par ces exploitations artisanales?
L’ayous, et plus spécifiquement ses coffrages, constitue de loin l’essence de bois la plus prisée et visible dans les zones urbaines du Cameroun. Omniprésents sur chaque nouveau chantier de construction, les coffrages d’ayous dominent le paysage. À ces essences s’ajoutent le dabéma et l’iroko. Ces trois essences représentent à elles seules entre 70 et 75 % du volume total de bois consommé sur les marchés urbains camerounais.
Quels sont les principales réussites et défis rencontrés lors de la mise en œuvre du projet PROFEAAC?
Le projet a connu des succès notables dans la structuration du marché intérieur du bois. Dans les deux communes pilotes, des sites de sciage légalisés sont en cours de mise en place, fruit d’une collaboration entre les autorités communales, l’administration et les entreprises privées. Ces espaces permettront aux acteurs de la filière de produire du sciage de qualité et d’origine légale. Une autre avancée majeure est le développement d’une méthode de détection de la dégradation forestière liée à l’exploitation artisanale, grâce à l’analyse d’images satellitaires. De plus, le projet a significativement contribué à la professionnalisation des exploitants artisanaux, les formant à des pratiques plus efficaces et rentables, et favorisant la création de coopératives pour un travail collaboratif.
Malgré ces avancées, des défis importants subsistent. La suspension des permis d’exploitation demeure un problème majeur, et la traçabilité reste quasi inexistante au sein de la filière. Un autre défi crucial est le faible niveau de demande des consommateurs pour du bois d’origine légale. Il est donc impératif de sensibiliser et de convaincre le public des avantages du bois légal, souvent de meilleure qualité et ayant un impact environnemental plus positif pour le Cameroun.
Comment est-ce que le ministère des forêts et de la faune a-t-il contribué à vos travaux?
Concrètement, la réussite du projet repose sur un véritable partage des tâches avec le ministère des forêts, qui a apporté son appui depuis l’élaboration jusqu’à la conduite du projet sur le terrain. C’est d’ailleurs le MINFOF qui a organisé l’atelier de ce 05 juin à Yaoundé. Surtout, cette synergie s’inscrit dans une relation de plus de dix ans avec le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), concrétisée par de nombreux projets communs. Je puis dire que cette collaboration étroite et fructueuse est d’autant plus remarquable qu’elle est rare avec d’autres administrations.
Quelles sont les difficultés avec les autres administrations?
Disons que la stabilité des équipes constitue un atout majeur pour la réussite des projets. Contrairement aux situations où les changements fréquents de personnel peuvent perturber les partenariats, la collaboration la Direction de la Promotion et de la Transformation du Bois du MINFOF se distingue par la longévité de ses membres. Cette continuité a permis d’établir des relations de confiance et de collaboration solides, essentielles pour avancer efficacement et dans la même direction. Cette équipe et nous partageons des objectifs et des moyens identiques, ce qui est rare pour un partenariat formel avec un ministère sur une décennie, et contribue grandement au succès des initiatives communes.
Comment le projet PROFEAAC a-t-il contribué à la sensibilisation des acteurs locaux sur les enjeux de la dégradation forestière et sur l’importance d’une exploitation légale et durable?
Des campagnes de sensibilisation variées ont été déployées, incluant de petits films, des flyers diffusés sur des plateformes comme Facebook et Twitter, à la télévision, à la radio, ainsi que dans la presse écrite, touchant ainsi le grand public. Parallèlement, le MINFOF, en collaboration avec le MINTP et le MINMAP, a réussi à faire adopter un arrêté imposant l’utilisation de bois d’origine légale dans tous les marchés publics. Ce texte, fruit de nombreuses années de travail, bien que n’étant pas encore pleinement appliqué, constitue une avancée majeure. L’enjeu désormais est de renforcer les moyens nécessaires à sa mise en œuvre effective et à son contrôle.
Quels sont les résultats scientifiques obtenus au cours de vos travaux et comment seront-ils utilisés pour orienter les politiques futures relatives à la gestion des ressources forestières?
Le projet PROFEAAC s’appuie sur une production intellectuelle variée, allant des articles scientifiques aux manuels, blogs et rapports techniques. Ces publications sont le fruit de recherches appliquées visant à éclairer les pratiques et les politiques de la filière bois.
Un axe majeur de ces travaux concerne la restauration forestière. Plutôt que d’imposer, l’approche consiste à comprendre les motivations des populations à planter des arbres. Les recherches ont permis d’identifier les facteurs de succès et d’échec de ces initiatives, ainsi que les raisons pour lesquelles certains individus sont plus enclins à s’engager. Ces connaissances sont cruciales pour développer des stratégies de restauration adaptées aux contextes locaux.
Par ailleurs, une autre publication scientifique, bientôt disponible, détaille les stratégies différenciées des exploitants artisanaux. Cette étude analyse comment ces acteurs adaptent leurs pratiques face aux variations de coûts, de prix, ou de ressources (essences d’arbres, diamètres). Enfin, les recherches ont également abouti à une méthode qui permet détecter la dégradation forestière causée par l’exploitation artisanale du bois, offrant un outil précieux pour le suivi environnemental. Ces exemples illustrent comment la recherche appliquée fournit des données concrètes et impactantes pour l’amélioration de la filière bois.
Lors de vos différentes présentations, vous avez évoqué certaines statistiques. Où ont-elles été confirmées et certifiées? Avez-vous travaillé avec l’Institut national de la statistique (INS)?
Non, nous n’avons pas travaillé avec l’Institut national de la statistique principalement parce que cette administration peine encore à appréhender pleinement l’importance économique des filières informelles dans la comptabilité nationale. Pour avoir collaboré avec ses équipes il y a quelques années, il apparaît clairement que ce type de secteur n’éveille pas un réel intérêt de leur part. En conséquence, nos collectes de données, nos traitements et nos analyses concernant ces filières ont été réalisés de manière indépendante, en dehors d’un cadre de collaboration avec l’INS.
Quelles suggestions pouvez-vous faire à l’INS pour susciter réellement son interet pour ces filières informelles?
J’envisage un travail en collaboration avec l’Institut national de la statistique cette année ou l’an prochain dans le but d’améliorer la prise en compte des filières informelles dans les estimations macroéconomiques de la comptabilité nationale. Il s’agira notamment de mieux intégrer des secteurs souvent négligés ou traités de manière ponctuelle et approximative par l’INS, tels que le bois d’œuvre destiné au marché domestique, les produits forestiers non ligneux ou encore le gibier. Autant d’activités qui, bien que relevant de l’informel, jouent un rôle économique majeur et restent largement sous-estimées dans les outils statistiques actuels.
Quels sont les projets ou initiatives futurs envisagés pour poursuivre le travail entamé par le projet PROFEAAC et garantir ainsi la durabilité des résultats obtenus?
Pour l’instant, nous achevons le projet en cours et n’en construisons pas immédiatement un nouveau. Toutefois, la question de la pérennité des résultats reste centrale. Elle repose sur le fait que nous avons travaillé en étroite collaboration avec les acteurs locaux — notamment les maires et les exécutifs communaux — ainsi qu’avec les acteurs privés, les marchés locaux et les filières déjà existantes. Ces partenaires, eux, resteront sur le terrain. Nous avons cherché à les appuyer, à les accompagner vers des pratiques plus efficaces et conformes à la légalité. Ce tissu d’acteurs engagés constitue la base d’une dynamique qui perdurera au-delà du projet. Même si notre accompagnement direct prendra fin, les structures et les dynamiques locales continueront d’exister, portées par des marchés en croissance et des filières bien ancrées. C’est cette continuité qui garantit en grande partie la durabilité des actions entreprises.
Alors que ce projet arrive à sont terme sur quoi faut-il mettre l’accent entre autres?
Il est essentiel de poursuivre les efforts de structuration de ce secteur, tant il se révèle efficace et vital pour de nombreuses personnes qui en dépendent, tant sur le plan économique que social. Toutefois, cette dynamique soulève légitimement des interrogations quant à son impact environnemental, en raison d’un encadrement encore faible et d’une régulation difficile à mettre en œuvre. Le soutien aux scieries de proximité, les « MIB physiques », correspond aux attentes exprimées par les marchés locaux du bois dans les communes productrices, et s’inscrit désormais dans l’orientation du ministère. Les expériences menées dans les deux communes où nous sommes intervenus ont démontré la faisabilité de cette approche. Bien que des recommandations plus détaillées aient été formulées, l’essentiel reste de maintenir le cap: les bases ont été posées, un chemin a été parcouru collectivement, mais de nombreux défis restent encore à relever.
Interview réalisée par Mireille Siapje