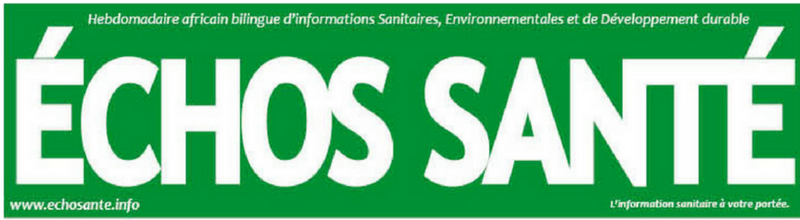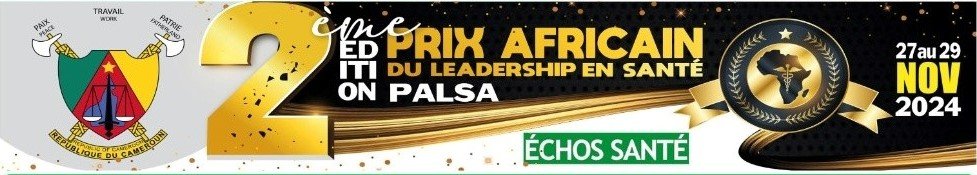L’étude, publiée dans le « Lancet », par les chercheurs de l’université d’Oxford et des scientifiques du Burkina Faso a porté sur 450 enfants et va maintenant faire l’objet d’essais à grande échelle.
Trouver un vaccin efficace contre le paludisme est considéré comme l’un des Graals de la recherche médicale. Il pourrait s’agir d’une percée majeure. Le paludisme est l’une des maladies les plus meurtrières : deux millions de victimes dont 600 000 enfants chaque année. Parmi les quatre espèces parasites, le plasmodium falciparum qui sévit en Afrique Noire est le plus dangereux. Face à ce triste bilan, la recherche d’un vaccin contre le paludisme a porté ses fruits. Lors de la deuxième phase des essais, ce nouveau vaccin a eu un taux d’efficacité de 77%. Il va maintenant faire l’objet de tests de plus grande envergure, menés dans quatre pays africains. Les près de cinq mille participants seront des enfants de moins de trois ans. Ce nouveau traitement n’a pas encore fait ses preuves. Mais il sera considéré comme un développement incroyablement prometteur au cours d’une année où les vaccins ont prouvé leur importance.
Chaque année, le paludisme est responsable de plus de deux millions de décès dans le monde. Face à ce parasite, la mise au point d’un vaccin représente un formidable espoir. Après des années d’échec, une nouvelle piste semble enfin prometteuse. Les chercheurs de l’université d’Oxford et des scientifiques du Burkina Faso ont mis sur pied un nouveau vaccin contre le paludisme. Lors des premiers essais, le vaccin s’est révélé efficace à 77 % contre la maladie. Un chiffre bien supérieur à celui de tous les traitements existants. L’étude, publiée dans le « Lancet », a porté sur 450 enfants du Burkina Faso et va maintenant faire l’objet d’essais à grande échelle.
Les chercheurs du monde entier travaillent depuis des années, à l’élaboration d’un vaccin nécessitant une coordination, des échanges, et des financements. La difficulté de mise au point vient du fait que le parasite se transporte d’un organe à un autre, exprime différents antigènes, selon les stades de son évolution et se « cache » dans les globules rouges à l’abri du système immunitaire. Enfin, la recherche ne dispose pas de modèle animal très fiable. Les rongeurs n’étant pas sensibles aux mêmes souches que l’homme. Même nos proches cousins les singes ne développent pas de troubles cérébraux comme l’homme.
L’Initiative Multilatérale de Lutte Contre le Paludisme (Multilateral Initiative on Malaria), lancée début 1997 a permis une augmentation importante du financement de la recherche sur le paludisme. Les vaccins en cours d’élaboration ou d’évaluation clinique s’attaquent actuellement soit à des antigènes exprimés par le parasite, soit aux globules rouges infectés. L’objectif est schématiquement de déclencher une ou plusieurs réactions immunitaires efficaces contre un grand nombre d’antigènes différents ou encore de trouver une molécule capable de neutraliser un antigène ou une molécule dont le parasite a besoin pour évoluer ou s’exprimer.
Elvis Serge NSAA